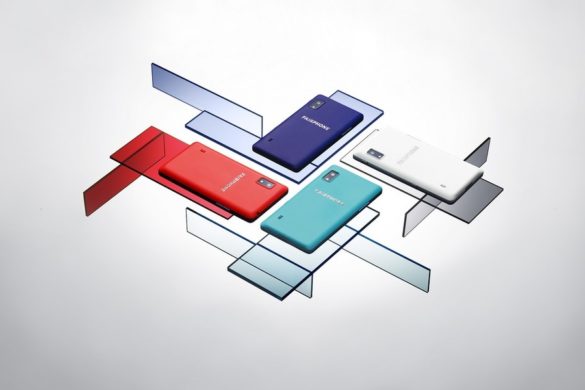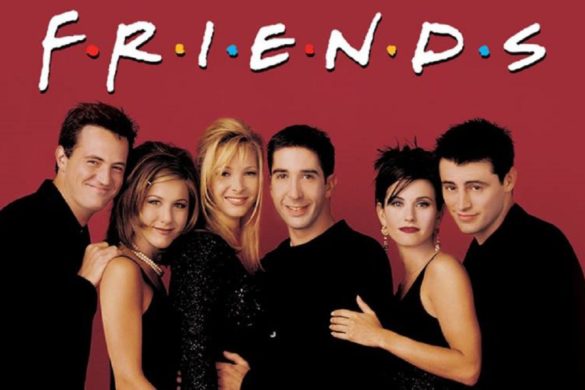A l’heure où j’écris cet article — en plein confinement —, je découvre la les opportunités dont regorge le temps à la maison. Entre autres, ma soif d’apprendre peut enfin prendre toute sa place, et je me suis dit que je n’étais pas la seule dans ce cas ! J’ai donc décidé de transformer un petit morceau de mon mémoire de Master en une série d’articles. Ne t’inquiète pas, rien d’indigeste, bien au contraire, difficile de faire plus cool comme sujet de mémoire que : la pornographie.
Permets-moi donc de te faire une petite présentation des porn studies, ou bien de l’étude sociologique de la pornographie, qui est un champ de la sociologie depuis les années 1970. De cette époque à aujourd’hui, les études sur le genre et la sexualité ont opéré un changement radical de perception de la pornographie. En effet, on passe d’un militantisme en faveur de l’interdiction de la pornographie à une étude de cette dernière comme un matériel culturel. A partir de la publication de l’ouvrage collectif Porn Studies, dirigé par Linda Williams en 2004, la pornographie devient un objet d’étude à part entière et s’extrait du débat sur l’existence des images en elles-mêmes.
Ceci est le deuxième article de la série. Tu trouveras le premier en cliquant juste ici, et la bibliographie en fin d’article !
Deuxième partie : le tournant pro-sexe des porn studies
Dans les années 1990, Linda Williams est donc l’initiatrice des porn studies. Professeure américaine, elle préfère expliquer les choix pornographiques actuels d’un point de vue cinématographique, sans pour autant nier une inégalité entre les sexes. Dans son ouvrage précurseur Hard Core : Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible, publié en 1989, la perspective historique semble fondamentale. Son but est d’ancrer la pornographie dans une histoire de l’image et du cinéma.
Outre les nombreux auteurs cités (Goldbarth, Freud, Foucault, Irigaray, etc.), l’auteure illustre ses propos avec des images d’archive et remonte jusqu’à Platon dans ses références historiques. L’autrice met en avant la recherche de visibilité qui traverse le cinéma et qui crée un principe de visibilité maximale dans la pornographie. Elle cite comme exemple la démocratisation de l’éjaculation masculine externe dans les années 1970, utilisée comme preuve visible du désir, du plaisir, de l’excitation. Par opposition, la difficulté à saisir complètement le désir sexuel féminin transforme la femme en objet sur lequel il faudrait enquêter, puisqu’on échoue à filmer son plaisir.
Selon Linda Williams, c’est de cette difficulté que provient la recherche d’une confession involontaire du plaisir de la femme qui alimente les scénarios de viol dans la pornographie, puisqu’il ne peut pas être mesuré objectivement, comme avec une éjaculation. Ce phénomène serait révélateur des standards masculins qui norment l’expression du plaisir féminin et donc échouent à le saisir et le comprendre : aveugles à la différence qu’ils recherchent, les yeux mécaniques de la caméra cherchent le désir féminin à travers le prisme de l’expression du plaisir masculin. D’où l’explosion des pornos avec « éjaculation féminine » !
Quelques années plus tard, en 2004, Heather Butler critique, dans son article « Que dit-on d’une lesbienne aux doigts longs ? » l’incapacité de la pornographie hétérosexuelle à représenter le désir féminin, affirmant que « les tentatives sont rares de représenter le plaisir féminin autrement que par un visage souriant et extatique couvert de sperme ». Elle oppose la pornographie hétérosexuelle ou « pseudo-lesbienne » (c’est-à-dire destinée à un public masculin) à la réelle pornographie lesbienne ou gouine.
Les porn studies commencent donc, à partir de leur création dans les années 1990, à envisager la pornographie comme hétérogène, constituée de groupes, de niches, de catégories, rendant difficile sinon impossible une définition fixe. C’est ce que met en avant François-Ronan Dubois, qui considère que pour parler de la pornographie, il est toujours nécessaire de procéder à une sélection préalable, ce qui fait que chaque discours la concernant a en réalité un objet d’étude différent. Ainsi, Susanna Paasonen se concentre sur un type de scénarios pornographiques quand elle écrit en 2007 qu’il est « explicitement question de contrôle, de soumission et de passivité du désir féminin dans les scénarios fantasmatiques qui reposent sur des relations sexuelles non consenties et mettant en scène des femmes trahies par le langage de leur corps ».
Par ailleurs, refuser d’appréhender la pornographie comme partie intégrante de la production culturelle nous empêcherait de pouvoir la considérer comme un objet d’étude. C’est ce que défend Laura Kipnis — théoricienne de la culture, spécialiste des émotions, de la sexualité et des rapports de classe dans la culture populaire américaine — dans son texte « Comment se saisir de la pornographie ? », écrit en 1996 et considéré aujourd’hui comme un classique des porn studies.
« Sous ces représentations empreintes de mépris qui font des consommateurs des marginaux et des solitaires, affleure en effet la reconnaissance du fait que la pornographie n’est pas seulement l’objet d’un penchant individuel mais aussi, et surtout, un élément central de notre culture. Je ne fais pas seulement référence à ses scores d’audiences et à son chiffre d’affaires. J’entends par là que la pornographie est révélatrice. Elle ne révèle pas que des corps nus, transpirant les uns contre les autres. Elle expose la culture à elle-même. »
Laura Kipnis
A partir du moment où l’on considère la pornographie comme porteuse de complexité culturelle, il nous est possible de « l’envisager au prisme de la fiction, du fantastique et de l’allégorique ». Cette perspective sur l’objet rend les sous-genres pornographiques moins étranges. Par exemple, de nombreuses catégories peuvent se recouper autour de l’érotisme de l’enfance censuré dans la société et qui ressort ici, avec la fessée, les couches-culottes, les chatouilles… La pornographie révèle donc la frontière poreuse entre l’enfance et l’âge adulte et marque les limites morales puisque, selon l’auteure, le sexe devient ici vecteur de ce qui est réprimé et la pornographie nous met face à ce que nous ne voulons pas savoir de nous-mêmes. Pour justifier cette thèse, Laura Kipnis s’appuie sur l’obsession provoquée par la pornographie puisqu’elle ne laisse personne indifférent et provoque des réactions intenses, du dégoût à l’excitation, du désir à la honte (notion que reprend Susana Paasonen). Ainsi, le regard est orienté vers ce qui est exclu, ce qui est transgressif — les corps gros, le travestissement ou la gérontophilie — et nous sommes confrontés à nos hypocrisies : que faire de nos valeurs féministes quand une scène de soumission ou de viol nous excite ?
La pornographie serait donc la matérialisation de la marge de notre culture, nous révélant une frontière à la fois collective et individuelle, mettant en relief nos limites. Par ailleurs, Laura Kipnis livre ici bataille contre l’élitisme culturel qui refuse d’admettre que la pornographie puisse être traversée d’enjeux politiques et puisse être un objet plus complexe que simplement l’expression de « la misogynie et la décadence sociale ». Ce discours sous-entend qu’il existe une hiérarchie culturelle et que la pornographie est tout en bas. La culture serait donc un système de classe où le porno est « associé aux traits des classes populaires » : on y dépeint un spectateur passif qui reproduit ce qu’il voit. Pour l’auteure, cela « montre l’hégémonie de la bourgeoisie » plus qu’un réel problème de mimétisme.
Si elle développe ici un discours militant contre l’élitisme culturel, elle est par conséquent très opposée aux antis-pornographie et critique les recherches sur lesquelles iels s’appuient. Pour elle, ce sont les personnes qui considèrent que la pornographie n’est pas légitime culturellement qui la rendent de plus en plus centrale. Par ailleurs, même si le texte de Laura Kipnis a été publié il y a plus de vingt ans, l’actualité de cette hiérarchie culturelle est incontestable. En effet, cette stigmatisation du public de la pornographie traverse les médias sans être remise en question. Par exemple, le 27 février 2017, Guillaume Erner, docteur en sociologie et chroniqueur à France Culture, fait passer sur les ondes sa chronique matinale sur les grocery hauls — filmer ses courses de la semaine et les poster sur YouTube —, se moquant des personnes qui filment et regardent ces vidéos, les comparant aux spectateurices de films pornographiques et les appelant des « mabouls ». Cette chronique illustre bien la hiérarchisation de certains objets culturels, en passant par le mépris de leur public.
Au-delà du monde universitaire, la pornographie a vécu de nombreuses évolutions et de nouvelles formes ont fait leur apparition. Celle qui nous intéresse particulièrement ici est la pornographie étiquetée « féministe » ou « pro-sexe », apparue depuis les années 1980 aux États-Unis. Tout comme Gayle Rubin qui défend l’épanouissement par le plaisir sexuel, ce nouveau genre cherche à proposer des films réalisés par des femmes pour des femmes, et se considère comme un outil de l’exploration du désir féminin et de son épanouissement. Le slogan d’Annie Sprinkle, « The solution to bad porn isn’t no porn, it’s better porn » s’engage clairement en opposition aux mouvements anti-pornographie et intègre dans ses films une part d’éducation sexuelle. La pornographie féministe serait donc éducative, ce qui en limite finalement sa portée en tant qu’objet pornographique.
Bibliographie :
Butler, H., « Que dit-on d’une lesbienne aux doigts longs ? Le développement de la pornographie lesbienne et gouine », in Vörös F., Cultures pornographiques, Anthologie des porn studies, Paris, Editions Amsterdam, 2015, p.184.
Dubois F.-R., Introduction aux porn studies, Les Impressions Nouvelles, 2014.
Paasonen S., « Étranges promiscuités. Pornographie, affects et lecture féministe », in Vörös F., Cultures pornographique, Anthologie des porn studies, Paris, Editions Amsterdam, 2015, p.72.
Kipnis L., « Comment se saisir de la pornographie ? », in Vörös F., Cultures pornographiques, Anthologie des porn studies, Paris, Editions Amsterdam, 2015, p.27.
Rubin G., Surveiller et jouir, Anthropologie politique du sexe, Paris, Epel, 2010.