Les origines de l’idéologie du travail
En cette période d’élections et de « clivages politiques », il y a me semble-t-il une idée qui continue de faire un consensus beaucoup trop large à mon goût : c’est l’idée selon laquelle travailler, ce serait une bonne chose. Mais qui est le premier à avoir dit une connerie pareille ?! Qu’il se dénonce !
En réalité le consensus me semble double, pour peu que l’on ait affaire à des interlocuteurs de bonne foi.
Premier consensus : tout le monde répétera à l’envi comme un perroquet que le travail est ce qui donne sens à la vie, qu’il faut par souci humaniste trouver d’urgence un travail à ceux qui n’en ont pas, et dès la maternelle donner le goût du travail à nos ingénieur·e·s et médecins du futur. Le « droit au travail » est même inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’humain de 1948 ! Et pourquoi pas le droit à la prison ou à la torture, ai-je envie de dire ?!
Et pourtant, un deuxième consensus contraire au premier saute également aux yeux : personne n’aime travailler ! « Quoi, il est déjà 7h !! » se récrie le travailleur endormi alors que son réveil lui hurle aux oreilles qu’il a du pain sur la planche ! « C’est quand les vacances ? » se demande la communauté entière des travailleurs, de la maternelle jusqu’à la veille d’une retraite tant attendue.
Comment rendre compte d’une telle dissonance cognitive ? Avons-nous affaire, hypothèse n°1, à une schizophrénie inévitable résultant de l’acceptation mal digérée d’un mal nécessaire ? Ou bien, hypothèse n°2, la dissonance ne serait-elle pas l’effet d’une idéologie délétère, celle du capitalisme, qui voudrait aller contre le rejet anthropologique et universel du travail ?
Hypothèse n°1 : Que le travail serait un mal nécessaire.
La première source idéologique qui intime à l’être humain de travailler c’est, comme bien souvent pour nous Occidentaux, la Bible. Le texte de la Genèse semble même offrir l’archétype de la dissonance cognitive qui nous occupe. En effet, le travail y reçoit une valeur des plus ambiguës. Dieu a interdit à Adam et Eve de cueillir le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois la transgression de l’ordre divin et le péché commis, Dieu en bonne logique les punit, et leur punition consiste justement à… travailler. En étant bannis du jardin d’Éden, ils n’auront plus accès sans aucune peine à leurs moyens de subsistance, mais Adam devra se lever de bonne heure pour travailler une terre aride et gagner son pain « à la sueur de son front », et Eve quant à elle n’est pas épargnée puisque son travail, le plus douloureux, sera celui de l’accouchement : « tu devras enfanter dans la douleur ». Le travail est donc un mal, puisqu’en tant que bonne punition, il fait mal ! Mais c’est un mal nécessaire, un mal juste, un mal voulu par Dieu, donc un bien.
On ne peut faire plus dissonant ! On a ici affaire à l’hypothèse n°1 que j’évoquais, celle d’un principe idéologique qui certes console les croyants par la reconnaissance de leur souffrance au travail, mais qui in fine justifie le fait de travail comme étant une nécessité, et même leur devoir. La religion n’a jamais autant joué sa fonction idéologique fondamentale bien décrite par Marx, celle des fleurs qui recouvrent nos chaînes, et qui consiste à plaindre les humains et à les consoler de leur oppression, tout en les conduisant à ne jamais mettre en cause ladite oppression.
Que l’hypothèse n°1 est une « fake news » depuis 10 000 ans !
C’est précisément cette première hypothèse : celle du travail comme un mal nécessaire, qui nous empêche de nous libérer. En effet, une fois reconnu le caractère nécessaire du travail, que reste-t-il à espérer, sinon un patron qui ne soit pas trop méchant et un salaire un peu décent ? Or, contrairement à ce que suggère le mythe biblique, cette hypothèse du travail nécessaire est fausse. C’est en tout cas ce que semblent démontrer les travaux des historiens et anthropologues.
Ainsi, l’anthropologue de l’économie Marshall Sahlins publie en 1972 Stone Age Economics (Traduction française en 1976 : Âge de pierre, âge d’abondance), dans lequel il entreprend de montrer que les sociétés dites « primitives » de chasseurs-cueilleurs, qui ont constitué 99 % des sociétés de notre histoire, n’étaient pas du tout des sociétés pauvres, qui auraient eu du mal à trouver leurs moyens de subsistance. Au contraire, leurs sources alimentaires étaient bien plus variées que celle des premiers agriculteurs. Ces derniers étaient exposés aux mauvaises récoltes, donc aux famines, et dont les monocultures pouvaient être la cause de sévères carences et de maladies. Contrairement aux idées reçues, ce mode de vie procure une bien plus grande sécurité que le mode de vie agricole. Or, c’est également un mode de vie qui procure à ses membres un temps libre bien plus grand que pour les agriculteurs. Sahlins décrit des individus oisifs, passant le plus clair de leur temps à se reposer, à faire des créations artistiques et à se raconter des histoires. Il ne faudrait certes pas verser dans le mythe du « bon sauvage ». Ces sociétés ont aussi été des sociétés superstitieuses et violentes à maints égards. Mais cela n’enlève rien au fait que, du point de vue du temps de travail, pendant 99 % de notre histoire nous avons décidé d’en faire le moins possible, 3 ou 4h par jour et de façon peu intense, juste ce qu’il faut pour nourrir tout le monde (soit peu de gens il est vrai).
Dans son best-seller Sapiens, l’historien Yuval Noah Harari confirme avec des données plus récentes ce qu’il appelle « la plus grande escroquerie de l’histoire », à savoir la révolution agricole qui s’est produite au Moyen-Orient voilà 10 000 ans environ. Bizarrement, les humains ont décidé de travailler 3 fois plus, et ce pour perdre en qualité de vie, en sécurité et variété alimentaire, en santé. La culture de céréales, du blé en particulier, s’est mise a exigé des humains des efforts considérables auxquels ils n’avaient jamais consenti auparavant. Le blé ne supporte ni les cailloux ni les autres plantes. Les agriculteurs doivent passer leurs journées à préparer le sol ; désherber ; à fabriquer des clôtures pour protéger les champs contre les espèces devenues « nuisibles » qui ravagent les récoltes ; à bâtir des systèmes d’irrigation pour abreuver une variété de céréales particulièrement assoiffée ; à fabriquer des outils, forger le fer, afin de travailler plus efficacement des les champs, etc. En somme, l’invention de l’agriculture fut aussi l’invention du labeur et de la division des métiers. Et la domestication du blé fut sans doute la cause matérielle qui pendant des millénaires inspira à nos ancêtres toutes ces lamentations mythologiques sur la souffrance inhérente à la condition humaine, et dont le récit de la Genèse est sans doute un lointain écho.
Dans son best-seller Sapiens, l’historien Yuval Noah Harari confirme avec des données plus récentes ce qu’il appelle « la plus grande escroquerie de l’histoire », à savoir la révolution agricole qui s’est produite au Moyen-Orient voilà 10 000 ans environ. Bizarrement, les humains ont décidé de travailler 3 fois plus, et ce pour perdre en qualité de vie, en sécurité et variété alimentaire, en santé. La culture de céréales, du blé en particulier, s’est mise a exigé des humains des efforts considérables auxquels ils n’avaient jamais consentis auparavant. Le blé ne supporte ni les cailloux ni les autres plantes. Les agriculteurs doivent passer leurs journées à préparer le sol ; désherber ; à fabriquer des clôtures pour protéger les champs contre les espèces devenues « nuisibles » qui ravagent les récoltes ; à bâtir des systèmes d’irrigation pour abreuver une variété de céréales particulièrement assoiffée ; à fabriquer des outils, forger le fer, afin de travailler plus efficacement des les champs, etc. En somme, l’invention de l’agriculture fut aussi l’invention du labeur et de la division des métiers. Et la domestication du blé fut sans doute la cause matérielle qui pendant des millénaires inspira à nos ancêtres toutes ces lamentations mythologiques sur la souffrance inhérente à la condition humaine, et dont le récit de la Genèse est sans doute un lointain écho.
Hypothèse n°2 : L’idéologie capitaliste nous fait croire que nous avons le devoir de travailler.
Mais alors si le travail n’a pas été un mal nécessaire pendant 99 % de notre histoire, s’il est lié à l’invention de l’agriculture, pourquoi continuons-nous à considérer le travail comme notre activité quotidienne principale et obligatoire, alors même que nous n’avons plus besoin d’autant de force de travail humain dans l’agriculture, depuis la mécanisation des outils agricoles ?
L’hypothèse qu’on peut défendre est que, même si le devoir de travailler date d’il y a 10 000 ans, c’est le système de production capitaliste qui depuis cinq siècles élabore et renouvelle sans cesse l’idéologie du travail.
Certes, le capitalisme n’est pas le premier système productif à utiliser l’idéologie du travail pour faire en sorte que les opprimé·e·s travaillent au service des oppresseurs. Dans son Éloge de l’oisiveté, Bertrand Russell esquisse une généalogie de l’idée selon laquelle travailler est un devoir. Elle s’enracine selon lui dès l’origine de la civilisation et va de pair avec la domination politique. « La notion de devoir, d’un point de vue historique, fut un moyen qu’ont employé les puissants pour amener les autres à consacrer leur vie aux intérêts de leurs maîtres plutôt qu’aux leurs. » Cela signifie que le devoir de travailler ne s’est toujours appliqué qu’aux classes justement appelées « laborieuses ». En effet, note Russell, tou·te·s les citoyen·e·s britanniques seraient choqué·e·s si l’on décidait que la Reine d’Angleterre, qui ne travaille pas sans que cela ne heurte personne, avait moins de ressources économiques qu’un ouvrier ou même un fonctionnaire moyen, qui travaille à temps plein. Cela montre bien que le le devoir de travailler est bien une idéologie : on ne peut pas montrer que c’est un principe moral universel, puisqu’à l’analyse il s’avère qu’on ne l’applique pas à tout le monde. Il est donc un principe qui prétend avoir une valeur universelle, alors qu’en réalité il n’est diffusé que pour persuader les classes laborieuses qu’il est de leur devoir de travailler pour les puissants, que c’est normal. Ce mécanisme qui consiste à donner une apparence morale et universelle à une réalité qui n’existe que pour favoriser les intérêts des puissants, c’est précisément ce que Marx appelle une idéologie.
Il est donc compréhensible que ce mécanisme joue également son rôle dans un système de production capitaliste. C’est le sociologue Max Weber, dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904), qui a décrit de façon remarquable la façon dont l’économie capitaliste et l’idéologie du travail se sont constitués conjointement, sur fond de réforme protestante. La convergence est d’abord chronologique, les deux phénomènes se développant en Europe à partir du XVIe siècle. Mais elle aussi intellectuelle. Le protestantisme affirme contre le catholicisme que la foi est avant tout un acte personnel qui ne repose pas sur les liens des fidèles avec des médiations et des sacrements, mais sur le rapport individuel et intimiste du croyant avec Dieu. S’ensuit la conviction que Dieu s’adresse personnellement et intimement à chacun, que chacun est appelé par Dieu. Cet appel rend tout croyant unique et responsable, en lui assignant une vocation, un devoir de réponse et une place singulière dans la communauté des croyants. Weber fait alors le lien entre l’appel de Dieu (Anruf en allemand) et la vocation ou le métier auquel chacun se voit assigné (Beruf en allemand). L’appel de Dieu est une tâche assignée, un devoir de contribuer à sa gloire en fonction de ses talents, un métier en somme.
Cette idée est accompagnée et corroborée par la valorisation protestante du travail. Alors que le catholicisme conserve une conception très ambigüe du travail, conçu comme une nécessité pour les laïcs, mais qui doit pour ceux qui en font leur profession, les ecclésiastiques, céder la place à une vie contemplative dédiée à la prière (« ora et labora » : « prie et travaille »), le protestantisme rend au travail sa dimension sacrée, et étend la dignité du service de Dieu non plus aux seuls ecclésiastiques, mais à toutes les activités, donc y compris les travaux séculiers. Ainsi le boulanger qui fait son pain rend à Dieu un service aussi agréable que le moine ou le prêtre. Ainsi disait déjà L’Ecclésiastique dans la Bible : « Sois attaché à ta besogne, occupe-t-en bien et vieillis dans ton travail ». Par conséquent, toute activité professionnelle devient une œuvre chrétienne, en ce que chacun·e, exerçant son métier, accomplit par là le devoir essentiel de tout chrétien : l’amour du prochain. Le corollaire de cette valorisation du travail, c’est la condamnation sans précédent de l’oisiveté et de la paresse (qui devient péché capital). « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » disait Saint Paul. La paresse est un refus de contribuer à l’œuvre de Dieu, et un refus de lui rendre Gloire.
Pourquoi cette éthique protestante du travail nous conduit-elle directement au capitalisme selon Weber ? D’abord parce que le propre du capitalisme, c’est précisément de ne plus limiter la somme de travail en fonctions des seuls besoins, mais c’est de travailler toujours plus pour produire plus. Il y a là une convergence paradoxale entre les deux logiques. Le protestant veut travailler plus parce que plus il travaillera, plus il montrera qu’il contribue à la gloire de Dieu et donc qu’il a obtenu la grâce. Le capitaliste lui veut travailler plus pour gagner plus, alors que l’appât du gain est rejeté explicitement par le protestantisme, qui ne condamne pas la richesse mais du moins encourage à la charité, à aider les pauvres, et invite le fidèle à mener une vie ascétique, en se privant des jouissances futiles pour se concentrer sur le travail. Cependant dans les deux cas le travail est vécu comme une fin en ce sens qu’il est détaché du besoin. Il faut travailler pour travailler. Parce que c’est bien de travailler.
L’esprit du capitalisme, qui est pour le coup introduit par l’éthique protestante, c’est l’idée du travail infini, qu’il faut toujours renouveler, accroître, rendre plus efficace. Ainsi en milieu protestant se développent des procédures de rationalisation totale du travail : éliminer les pertes de temps, les démarches absurdes. Le vendeurs ou le propriétaire augmentent les contrôles sur ses fournisseurs, ils exigent davantage d’eux, ils leur imposent des normes de qualités en fonction des attentes de l’acheteur qui est lui aussi concerté. Ainsi s’accroît la dépendance de chaque travailleu·r·se à l’égard du système entier de l’économie, et les conditions de travail se durcissent. Les retards dans les commandes, les défauts de fabrications, les longues pauses ou arrêts octroyées pour des motifs désormais jugés irrationnels, toutes choses qui étaient monnaie courante dans l’économie chrétienne médiévale, sont bannies progressivement.

Aujourd’hui la religion ne joue plus tellement un tel rôle idéologique, et ce n’est pas elle qui est en première ligne pour tenir le beau discours ; ce discours qui persuade les gens qu’il est de leur devoir de travailler et de se lever tôt le matin, tout en leur cachant qu’ils ne le font que pour enrichir les puissants. La religion n’a même plus besoin de tenir un tel discours : il est partout, dans la bouche des religieux aussi bien que des athées. La logique du rendement, de la rationalisation du temps est partout, dans les écoles aussi bien que dans les entreprises, pendant nos vacances qui doivent être productives aussi bien que dans notre temps officiellement travaillé.
Aussi plus que jamais l’idée qu’il faut moins travailler semble relever de l’utopie. Et pourtant il n’y a pas si longtemps de partis politiques et des syndicats défendaient la retraite à 55 ans (la CGT dans les années 90) ou la semaine de 30h, et rencontraient un certain écho.
Quels sont donc les arguments actuels qui pourraient nous convaincre que le fait de travailler moins est non seulement possible, mais même souhaitable individuellement et collectivement, c’est ce que l’on verra dans un prochain article…, un jour, car pour le moment j’avoue que j’en ai un peu marre de travailler, bénévolement en plus ! et par souci de cohérence je m’accorderais bien quelques vacances…
Sources :
– Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance (1972)
– Yuval Noah Harari, Sapiens. Une brève histoire de l’humanité (2012)
– Bertrand Russell, Éloge de l’oisiveté (1932)
– Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904)
Images :
– Michel-Ange, Le Chagrin et la colère (dans l’article)
– Jean-François Millet, L’Angélus (illustration article)



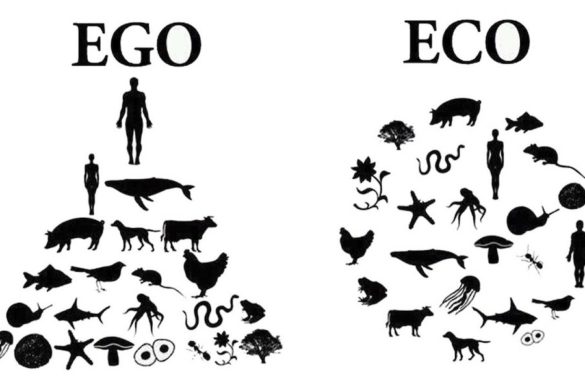


3 Commentaires
Merci pour cet article très pertinent ! J’habite depuis 20 ans en Allemagne et je baigne effectivement dans la culture protestante de la valorisation du travail. Votre article permet de prendre un peu de recul…
Oui mais comment tu définis le « travail » ? Si la reine d’Angleterre ne travaille pas, alors est-ce que l’ambassadeur ne travaille pas non plus ? Est-ce que s’occuper de ses enfants ou faire le ménage chez soi c’est travailler ?
Je pense que la définition de ce qu’est le travail est au cœur de la lutte sociale, et quand on milite pour réhabiliter l’oisiveté, on perd la bataille. Au contraire, il faut militer pour le travail, celui des esclaves, des serfs et des prolétaires (contre l’oisiveté des maitres, des seigneurs et des bourgeois), et reprendre le contrôle de ce qui doit ou non entrer sous la catégorie de « travail ». Moins travailler n’est pas souhaitable (et peut-être même pas possible), par contre il faut lutter contre l’emploi (le fait que le travail soit soumis au marché du travail) pour promouvoir un travail libre et réalisateur de soi (comme, au hasard, écrire des articles de philo sur internet).
Je suis bien d’accord qu’il faille distinguer le travail en général, qui désigne toute activité de transformation de la nature ou de soi qui nécessite du temps, des efforts et des compétences, et le travail au sens économique, l’emploi. Certes, je visai avant tout l’emploi de mon article, mais je ne crois pas qu’il faille pour autant valoriser absolument le travail en général contre l’oisiveté. Ne penses-tu pas que la tendance à valoriser le travail non salarié, travail domestique ou travail personnel du loisir, comme étant une source d’épanouissement personnel, est un écho voire une application directe dans notre idéologie de la valeur-travail telle qu’elle a été défendue dans toute l’histoire par la classe dominante dont les intérêts économiques étaient de faire travailler les autres ? Ne penses-tu pas qu’un travail enfin libéré du chantage économique inhérent au capitalisme sera un travail avant tout… moindre ? La logique du moindre effort, attestée biologiquement, ainsi que les données anthropologiques sur la durée de travail dans les sociétés non modernes invitent plutôt à penser que l’oisiveté demeure préférable tant qu’elle est possible. Le travail domestique a beau ne pas être soumis au chantage capitaliste, il reste une contrainte, celle de la reproduction des moyens de subvenir aux besoins. En ce sens, je ne pense pas que les solutions purement marxistes au problème du travail abstrait soient les seules pertinentes, et ce n’est pas cet enjeu que je traite ici. Je m’intéressai plutôt à la question anthropologique du travail par opposition à l’oeuvre ou à l’action, telle que la pose Arendt.